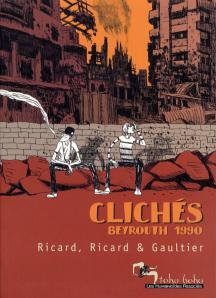Tout a commencé sur les bancs de la Fac. Une fille repère un gars et cherche à attirer maladroitement son attention. Puis, surprise, lors d’une soirée étudiante : l’un comme l’autre sont invités. L’alcool aidant, les affinités se créent.
Quelques années plus tard, on les découvre mariés et toujours aussi amoureux. L’homme a obtenu une bonne promotion professionnelle qui les met à l’abri du besoin et juge que sa femme n’a pas besoin de travailler. La routine s’installe, elle se cantonne dans ses tâches domestiques et lui se laisse déborder par le stress professionnel. Il ne trouve aucun exutoire. A la suite d’un désaccord conjugal assez anodin, son seul moyen d’obtenir gain de cause sera physique. Il la gifle. Elle lui pardonne… La violence va progressivement s’installer dans leurs relations.

« Convenu ». C’est un peu ce que je me suis dit en sortant de cet album. Je m’attendais effectivement à un traitement plus original des violences conjugales. Mais si la manière de faire est différente, j’ai déjà entendu ce discours-là. Une fois encore, encore, mon regard critique est influencé par le fait que je travaille dans le Social. Étant sensibilisée à ce sujet, j’attendais certainement que les auteurs frappent les esprits à l’aide d’un traitement narratif plus mordant mais surtout, j’en attendais une réflexion constructive. Rien de tout cela ici. La violence s’étale tout au long de l’album. Si les scènes de violences sont suggérées, leurs conséquences physiques le sont moins mais c’est à la partie graphique qu’on doit leur présence (James ne cache pas les stigmates sur le corps de la jeune femme). Sans surprise, Sylvain Ricard s’attarde donc sur l’aspect psychologique de ce mécanisme. Mais l’utilisation de personnages stéréotypés conduit à un dénouement prévisible. La présence de quelques soubresauts narratifs m’a longtemps laissé croire qu’enfin, le récit pouvait conclure de manière innovante. Mais les représentations sur ce sujet ont la peau dure. Si cet ouvrage est une fenêtre ouverte sur le quotidien de milliers de femmes battues en France, il n’apporte rien de nouveau quant à la manière de traiter le sujet en bande dessinée. Le seul ouvrage qui a retenu mon attention sur cette question est En chemin elle rencontre. Les autres titres nous font tourner en rond.
Mais c’est bon, c’est réglé. Il s’est excusé. Il a juré qu’il ne recommencerait pas.
Pour servir les propos du scénariste, James a opté pour un monde anthropomorphique dans des teintes sépia. Un choix pertinent puisqu’il permet de décaler le regard, donne de la force aux textes. Il montre à quel point cette femme vit dans le passé, retenue par ses souvenirs heureux en compagnie de son homme. Le trait est tout en retenue, à l’instar de la victime qui mesure ses propos, anticipe les événements pour éviter tant que possible le courroux du mâle dominant. Pour moi, l’originalité de cet album tient à la partie graphique qui nous force à décaler le regard pour mieux observer le drame qui se déroule.
![]() Un album que je trouve trop conventionnel et trop délicat comparé à la réalité. Certes, il montre à quel point cette violence est imprévisible. Certes, il montre qu’aucun couple n’est à l’abri et ce, quelque soit le milieu social. Sans forcément m’attendre à ce que les auteurs livrent en pâture leurs personnages à une violence surajoutée, je venais chercher dans cet album une réflexion constructive, chose qu’Inès et Léa ne se souvient pas comment fonctionne l’aspirateur n’avaient su proposer.
Un album que je trouve trop conventionnel et trop délicat comparé à la réalité. Certes, il montre à quel point cette violence est imprévisible. Certes, il montre qu’aucun couple n’est à l’abri et ce, quelque soit le milieu social. Sans forcément m’attendre à ce que les auteurs livrent en pâture leurs personnages à une violence surajoutée, je venais chercher dans cet album une réflexion constructive, chose qu’Inès et Léa ne se souvient pas comment fonctionne l’aspirateur n’avaient su proposer.
Mais une nouvelle fois, on nous montre la même facette du combat, comme si les femmes étaient d’éternelles victimes et n’avaient pas d’autres alternatives à la soumission… Comme si le silence était le meilleur remède à ses maux… Comme s’il n’y avait pas de combat contre cette fatalité…
L’avis de Choco, de Joëlle, Enna, Catherine, Ys, Yvan, Hop blog, Ginie, Antigone.
Un article de Phylacterium consacré à James.
Extraits :
« Je sais que si je continue à me comporter de la sorte, je vais perdre ma meilleure amie. Mais j’ai l’impression qu’elle vient me voir comme si on va voir un vieux à l’hospice. Par habitude, par devoir, pour soulager une conscience un peu chiffonnée. Et ça me dérange. Je l’imagine assez bien parlant de moi à ses amies, ses collègues… Vous savez, mon amie qui se fait battre par son mari. Et eux, unanimes pour dire que ça ne devrait pas être permis, à y aller de leur fait divers, de leur anecdote. De leur analyse profonde et pleine de bon sens arborant leur costume de justicier ou de professeur de morale » (… à la folie).
« J’aime ma femme et elle le sait. Et je sais qu’elle le sait. D’ailleurs je suis sûr qu’elle aussi a toujours des sentiments pour moi. C’est vrai que je n’ai pas été toujours délicat avec elle. C’est vrai. Mais quand même, je subis énormément de tension au travail et ce n’est pas toujours simple de rester maître de soi. Alors oui, il m’est arrivé de sortir de mes gonds, pas toujours de la bonne manière, mais toujours pour une bonne raison » (… à la folie).
… à la folie
One Shot
Éditeur : Futuropolis
Dessinateur : JAMES
Scénariste : Sylvain RICARD
Dépôt légal : septembre 2009
ISBN : 9782754803021
Bulles bulles bulles…
Les 11 premières pages sur Digibidi.
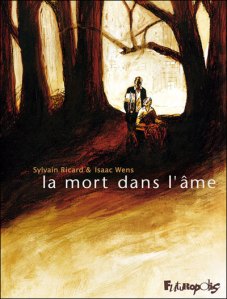
 La Mort, la Foi, l’euthanasie et une relation père-fils touchante sont les ingrédients de cet album qui n’est pas évident à lire. Il faut trouver le moment opportun pour accueillir cette fiction qui met en scène un processus de deuil douloureux et la lente détérioration physique et psychologique d’un individu. Je sors émue et satisfaite de cette lecture.
La Mort, la Foi, l’euthanasie et une relation père-fils touchante sont les ingrédients de cet album qui n’est pas évident à lire. Il faut trouver le moment opportun pour accueillir cette fiction qui met en scène un processus de deuil douloureux et la lente détérioration physique et psychologique d’un individu. Je sors émue et satisfaite de cette lecture.