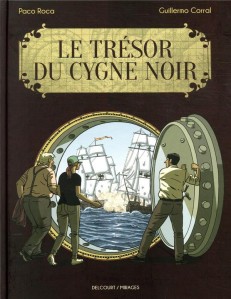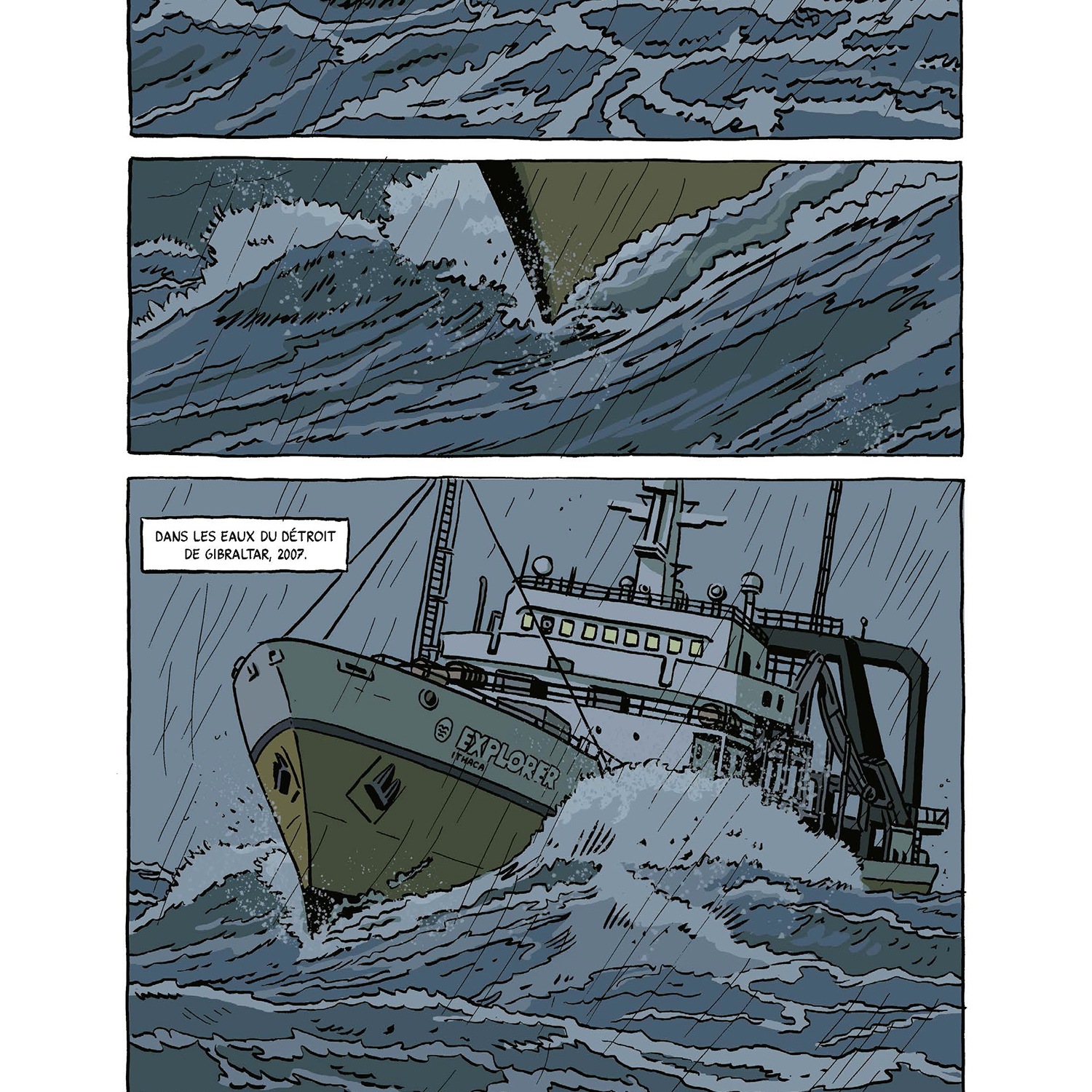« L’univers célinien est un opéra bouffe, avec de grandes machines à voix et trompettes et tambours… C’est la féerie Céline… au cœur d’un cauchemar peut-être… mais c’est la féerie… toute en frou frou, légère et mutine… » écrit Christophe Malavoy dans la préface de cet album qu’il dédie à Lucette Destouches, épouse de Louis Ferdinand Destouches, dit Louis-Ferdinand Céline… artiste incontesté… homme contesté pour le rôle qu’il a joué et les opinions qu’il a défendues dès la fin des années 1930 et pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Sitôt la lecture commencée, on est interpellé vertement par Céline lui-même. Il est vieux, alité et écrit de façon frénétique… certainement pour s’échapper de ce terrible quotidien. Il a un besoin furieux de parler, de vider le trop plein d’amertume. Il se sait méprisé, il se sait jugé pour des décisions qu’il a prises, des choix contestables. Il s’en moque. Il veut s’expliquer, donner son point de vue… et le jeter en pâture… les gens penseront ce qu’ils voudront. Avec fermeté, le célèbre écrivain prend les commandes de la narration et pointe les fissures de sa carapace. Il montre son Yin et son Yang, l’homme dégueulasse et l’homme humaniste… Docteur Destouches et Mister Céline… un personnage tout en contradictions. Il se fustige, reconnaît ses agissements, son ambiguïté et s’en défend. Au crépuscule de sa vie, il revient sur les cinq mois qu’ont duré sa fuite. Cinq mois qui l’ont profondément ébranlé. Retour…

… en octobre 1944. La France est encore sous l’occupation allemande. A Paris, la guerre prend tout le monde en étau. L’air est irrespirable et Céline se morfond dans comme un lion en cage. Il continue à assurer le suivi de ses patients et, de temps en temps, se rend au chevet de malades clandestins.
Il tait à tous – excepté à sa femme – les menaces qu’il reçoit presque quotidiennement. Mot d’insultes, menaces de mort… il décide de quitter Paris avec son épouse et avec son chat. Ils souhaitent rejoindre les Pays-Bas… mais en temps de guerre, ce voyage les obligera à faire bien des haltes. A Baden-Baden, ils s’installent au Brenner, un hôtel truffé d’allemands. Céline tente de s’y faire le plus discret possible mais un attentat est perpétré contre Hitler et les Allemands décident de se replier en lieu sûr. Les ordres sont donnés… et Céline affecté, malgré lui, au Ministère de la Santé à Berlin.
Un impondérable conséquent alors que sa cavale ne fait que commencer…



Ça grince. L’ambiance graphique des frères Brizzi est ciselée au crayon de papier. D’un bout à l’autre, pas de chichis ni de fioritures. Un pur bijou. Mais ça grince oui. Quelques jolis minois apparaissent au milieu de visages antipathiques, à commencer par Céline qui fait la gueule en permanence. Suspicieux, mécontent, il sait à quoi s’attendre de ses semblables et préfère les éviter. Ne compter que sur lui pour sauver sa peau et celle de sa femme. Il est aigri. Il a fui Paris et ses coupe-gorges pour aller se terrer dans des bouges encore plus crasseux, où fourmille la vermine nazi… ou la crasse pétainiste.
« La vie !… Ah ! J’ai été bien servi, merci !… ça oui ! Vraiment du bon et puis beaucoup de mauvais !… Ça aussi, ça remonte à la gorge… la condition humaine, c’est la souffrance, n’est-ce pas ?… »
Céline est dépeint comme un homme acariâtre. Sa mauvaise humeur constante fait partie du personnage. En adaptant la trilogie allemande (D’un château l’autre, Nord et Rigodon) de Céline, Christophe Malavoy se concentre sur les temps forts de l’exil de l’écrivain et donne une lecture possible des intentions de l’homme trouble qu’il fut. Pour se mettre à l’abri, Céline a joué l’opportuniste et n’a pas hésité pas à se mettre sous la protection de la lie de l’humanité : nazis, collabos. L’homme cultivé et instruit est même allé se terrer dans l’antre de Pétain à Sigmaringen. L’instinct de survie l’a conduit à prendre des chemins tortueux, boueux, nauséeux. Dans sa cavale, il croise la débauche et la folie, des hommes et des femmes en pleine dérive. Pourtant, quelques soient les circonstances et conscient des risques qu’il prenait, il a continué à soigner les pauvres, les réfugiés, les clandestins, les déserteurs… Céline ferme les yeux sur l’identité de ses patients. Humble, il ne s’est jamais targué d’avoir dépensé des fortunes pour permettre à ceux qui sont dans le besoin d’avoir accès aux soins. Christophe Malavoy ne se fait ni juge ni partie. Le scénariste fait ressortir avec brio toute l’ambiguïté de son personnage et du combat que ce dernier a mené avec ses propres démons.


Un album fort, sombre où Louis-Ferdinand Céline joue son propre rôle, celui d’un homme cynique, désabusé et très épris de sa compagne.
Un moment de lecture partagé avec Marilyne. Je vous invite à vous rendre sur Lire & Merveilles pour lire sa chronique.
La Cavale du Docteur Destouches (récit complet)
[Adaptation de la trilogie de Louis-Ferdinand Céline : D’un château l’autre, Nord et Rigodon]
Editeur : Futuropolis
Dessinateurs : Paul BRIZZI & Gaëtan BRIZZI / Scénariste : Christophe MALAVOY
Dépôt légal : septembre 2015 / 96 pages / 17 euros
ISBN : 978-2-7548-1173-6